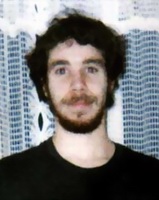Profil et enfance
Une enfance marquée par des troubles familiaux et des comportements problématiques
Albert DeSalvo, né le 3 septembre 1931 à Chelsea, dans le Massachusetts, a grandi dans une famille dysfonctionnelle et pauvre. Son père, Frank DeSalvo, était un homme violent et alcoolique qui infligeait régulièrement des abus physiques et psychologiques à sa femme et à ses enfants. Ce climat familial toxique laissa des marques profondes sur Albert, qui développa un sentiment d’insécurité et un besoin constant de validation.
Sa mère, Charlotte DeSalvo, tentait de protéger ses enfants des violences paternelles, mais elle était elle-même victime de ce cadre oppressif. Malgré ses efforts, elle peinait à offrir une stabilité émotionnelle à Albert, ce qui accentua son isolement psychologique.
Dès son jeune âge, DeSalvo montra des comportements préoccupants, notamment une tendance à manipuler son entourage et une fascination pour les actes de domination. À l’école, bien qu’il fût décrit comme aimable et sociable en apparence, ses pairs et enseignants remarquèrent rapidement des traits de personnalité atypiques, marqués par des écarts de comportement soudains.
Ce mélange de violence familiale et d’isolement social contribua à façonner une personnalité complexe, cherchant sans cesse à compenser par des actes extrêmes le sentiment d’infériorité et d’impuissance accumulé durant son enfance.
Adolescence : premiers signes de déviance
Pendant son adolescence, Albert DeSalvo commença à manifester des comportements de plus en plus inquiétants. Bien qu’il tentât de maintenir une façade de normalité, il montra un intérêt accru pour les actes d’intimidation et de contrôle sur autrui. Il se fit remarquer pour ses actes de voyeurisme et sa propension à enfreindre les règles sociales sans ressentir de culpabilité.
À cette période, DeSalvo développa également une habileté troublante pour manipuler et convaincre. Il savait utiliser son charme apparent pour détourner l’attention des figures d’autorité, tout en dissimulant ses intentions réelles. Ce besoin de domination et de validation devint central dans sa vie.
Son adolescence fut également marquée par plusieurs incidents mineurs de délinquance, qui reflétaient déjà une incapacité à se conformer aux normes et un mépris croissant pour l’autorité. Bien que ces premiers actes n’aient pas directement attiré l’attention des autorités, ils révélèrent les prémices de son comportement criminel futur.
Parcours criminel
Les premières infractions : l’émergence d’un prédateur
Albert DeSalvo débuta sa carrière criminelle par des délits mineurs. Dans les années 1950, il fut arrêté pour des infractions liées à l’entrée par effraction et au vol. Cependant, ces délits n’étaient que la partie émergée de l’iceberg : à cette époque, il menait déjà une double vie, développant un besoin compulsif d’agresser et de contrôler ses victimes.
Un tournant majeur dans son parcours criminel survint lorsqu’il fut surnommé « Le Mesureur » après une série d’agressions sexuelles dans lesquelles il utilisait un prétexte de représentant en vêtements pour approcher ses victimes. Sous ce faux prétexte, il les convainquait de lui permettre de prendre leurs mensurations avant de commettre des agressions sexuelles.
Malgré plusieurs arrestations, DeSalvo échappa à des peines sévères en raison de son habileté à manipuler son entourage, notamment les enquêteurs. Ces premiers actes révélèrent un mode opératoire basé sur la ruse et la confiance, préfigurant les crimes plus graves à venir.
L’escalade vers les meurtres : une violence calculée
Entre 1962 et 1964, Albert DeSalvo entama une série de meurtres brutaux qui semèrent la terreur à Boston. Sous le surnom du « Tueur de Boston », il assassina 13 femmes, âgées de 19 à 85 ans, dans leurs appartements. Ces crimes, caractérisés par une violence extrême, étaient marqués par des signes de strangulation, souvent avec des bas ou des cordons, et des mutilations post-mortem.
Son mode opératoire consistait à s’introduire chez ses victimes sous prétexte de réparations ou d’un service quelconque. Une fois à l’intérieur, il gagnait leur confiance avant de les attaquer brutalement. Ce schéma révélait une personnalité méthodique et calculatrice, mais également une rage profonde dirigée contre les femmes.
Les enquêteurs furent frappés par le contraste entre l’apparente normalité de DeSalvo et la cruauté de ses actes. Marié et père de famille, il menait une vie ordinaire en apparence, ce qui lui permit d’échapper aux soupçons pendant plusieurs années.
Série de crimes
Les victimes connues : une série glaçante
Albert DeSalvo est accusé d’avoir tué 13 femmes, bien que certains de ces meurtres fassent encore débat quant à son implication. Parmi ses victimes les plus emblématiques :
- Anna Slesers (55 ans, 1962) : La première victime connue du « Tueur de Boston », retrouvée étranglée dans son appartement.
- Mary Sullivan (19 ans, 1964) : La plus jeune des victimes, son meurtre choqua particulièrement par la violence des mutilations.
- Evelyn Corbin (58 ans, 1963) : Retrouvée nue et étranglée chez elle, un meurtre typique du modus operandi de DeSalvo.
Ces crimes, souvent commis dans des appartements sans effraction apparente, soulignaient la capacité de DeSalvo à manipuler et désarmer ses victimes avant de les attaquer.
Un climat de peur généralisé
Les meurtres attribués à Albert DeSalvo plongèrent Boston dans un état de terreur. Les femmes, en particulier celles vivant seules, modifièrent leurs habitudes, verrouillant leurs portes et évitant les inconnus. La médiatisation de l’affaire amplifia cette peur, avec des gros titres relatant chaque nouveau meurtre et spéculant sur l’identité du tueur en série.
Les autorités furent critiquées pour leur incapacité à relier les crimes plus rapidement, bien que l’absence de technologies modernes d’investigation, comme les tests ADN, compliquât leur tâche.
La traque et l’arrestation
Une arrestation indirecte
Albert DeSalvo ne fut pas immédiatement identifié comme le tristement célèbre « Tueur de Boston ». À l’époque des meurtres, les autorités de Boston faisaient face à une vague de crimes similaires sans parvenir à établir de liens concluants entre eux. Les techniques modernes d’investigation, telles que les analyses ADN, n’étant pas disponibles, les enquêteurs devaient se fier aux témoignages, aux scènes de crime et aux schémas comportementaux pour progresser.
C’est en 1964, après une série d’agressions sexuelles perpétrées sous son rôle de « Mesureur », qu’Albert DeSalvo fut finalement appréhendé. Dans cette série de délits, DeSalvo approchait ses victimes en se faisant passer pour un représentant en vêtements, offrant de mesurer leurs mensurations. Une fois leur confiance gagnée, il les agressait sexuellement. Ces crimes, bien que graves, semblaient distincts des meurtres brutaux qui terrorisaient Boston.
Lors de son arrestation pour ces agressions, DeSalvo ne correspondait pas au profil habituel d’un tueur en série. Marié, père de famille, et ayant une apparence rassurante, il incarnait une image d’ordinaire qui dissimulait sa véritable nature. Ce n’est qu’après son incarcération dans un établissement pénitentiaire qu’il entama des confidences troublantes à l’un de ses codétenus, George Nassar. Ces aveux comprenaient des détails spécifiques sur les meurtres du « Tueur de Boston », des informations que seul le véritable auteur aurait pu connaître.
Cette révélation marqua un tournant dans l’enquête. Bien que les enquêteurs aient été sceptiques au départ, les descriptions précises de DeSalvo sur les scènes de crime et les méthodes utilisées les convainquirent qu’il était probablement responsable des meurtres.
Les révélations troublantes
Les aveux d’Albert DeSalvo concernant les meurtres du « Tueur de Boston » furent à la fois une avancée majeure et une source de frustration pour les autorités. Lors des interrogatoires, DeSalvo se montra remarquablement coopératif, fournissant des détails minutieux sur les 13 meurtres attribués au tueur. Il décrivit avec une précision glaçante comment il gagnait la confiance de ses victimes, les attaques brutales, et les scènes de crime. Ces descriptions correspondaient aux preuves collectées, renforçant l’idée qu’il était bien l’auteur des crimes.
Cependant, un obstacle de taille compliqua l’affaire : aucune preuve matérielle directe, comme des empreintes digitales ou des témoins oculaires, ne liait formellement DeSalvo aux scènes des meurtres. De plus, certains experts doutaient de la véracité de ses aveux, suggérant qu’il aurait pu exagérer ou inventer ces récits pour attirer l’attention ou se forger une réputation en prison.
Lors de son procès, Albert DeSalvo plaida non coupable pour raison d’aliénation mentale. Ses avocats tentèrent de démontrer que ses actions et ses aveux résultaient de troubles psychologiques graves, notamment d’une personnalité dissociative. Cette stratégie visait à éviter la peine de mort et à obtenir son internement dans un hôpital psychiatrique plutôt qu’une prison.
Bien que ses confessions sur les meurtres fussent accablantes, DeSalvo ne fut jamais formellement jugé pour ces crimes en raison du manque de preuves irréfutables. Il fut néanmoins condamné à la prison à vie pour ses agressions sexuelles en tant que « Mesureur ».
Ces révélations laissèrent une impression durable sur l’opinion publique et les forces de l’ordre. Si certains le considèrent comme le véritable « Tueur de Boston », d’autres restent sceptiques, laissant planer une aura de mystère autour de l’affaire. L’ADN prélevé des décennies plus tard sur une des scènes de crime confirmerait finalement en partie son implication, mais le débat persiste sur la possibilité que d’autres tueurs aient également été actifs à cette époque.
Condamnation et impact
Une figure emblématique de l’horreur criminelle
Albert DeSalvo est un des pires tueurs en série, et fut condamné à la prison à vie pour ses agressions sexuelles, mais son rôle dans les meurtres continua de diviser les experts. En 1973, il fut assassiné par un codétenu, mettant fin à l’un des chapitres les plus troublants de l’histoire criminelle américaine.
Impact social et judiciaire
L’affaire DeSalvo mit en lumière l’importance des enquêtes criminelles coordonnées et de l’utilisation de preuves scientifiques. Elle sensibilisa également les femmes aux dangers des interactions avec des inconnus, modifiant durablement les comportements et les perceptions de sécurité dans les grandes villes.